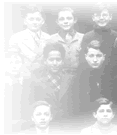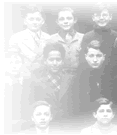Le chat de Mr Descartes 1
En ma qualité d'historien de la philosophie française à l'âge classique, j'avais été sollicité pour consultation par mon vieil ami Simon Lepêcheur, embarrassé par la tâche dont l'avait chargé la Société des Études Post-cartésiennes : il était moins à l'aise dans le latin philosophique du dix-septième siècle que dans celui des chartes lituaniennes du treizième, dont sa connaissance approfondie lui avait valu un rang plus qu'honorable au concours de sortie de l'École, .png) et du coup sa charge de Conservateur de la riche Bibliothèque de l'ancien Couvent des Bernardins à Ussel. En tout état de cause, sa pratique du latin quel qu'il fût était un peu lointaine, et il était, de façon générale, peu porté sur la philosophie, accaparé qu'il était depuis de nombreuses années par la recension, l'étude, et la publication des recueils de poésie érotique de langue d'oc en Auvergne et Limousin sous le Directoire et au début du Consulat. et du coup sa charge de Conservateur de la riche Bibliothèque de l'ancien Couvent des Bernardins à Ussel. En tout état de cause, sa pratique du latin quel qu'il fût était un peu lointaine, et il était, de façon générale, peu porté sur la philosophie, accaparé qu'il était depuis de nombreuses années par la recension, l'étude, et la publication des recueils de poésie érotique de langue d'oc en Auvergne et Limousin sous le Directoire et au début du Consulat.
C'est bien à lui pourtant qu'incombait désormais la tâche d'ouvrir le dossier d'une correspondance inédite de Descartes que Clerselier avait jugé préférable de laisser de côté dans son édition : ce dernier indiquait qu'elle devait demeurer inconnue pendant au moins trois siècles, en attendant que les passions et controverses soulevées par le Maître et sa doctrine se fussent tout à fait calmées, que le progrès des recherches cartésiennes eût apporté toutes les lumières nécessaires à la compréhension et l'interprétation de textes comme ceux-là, que, en particulier, on eût définitivement cessé de s'interroger sur sa religion, ses rapports à l'Église, à ses dogmes, à ses institutions et aux membres de celles-ci.
Les démentis apportés par les faits à l'optimisme ainsi affiché par l'éditeur de ses Lettres, en ce qui concerne surtout le dernier point, expliquaient qu'on eût préféré attendre encore quelques dizaines d'années pour procéder enfin à la rupture des scellés, et découvrir les pièces de cette correspondance inédite avec Chanut, dont Clerselier paraissait bien en effet n'avoir pas eu tort de s'inquiéter « qu'elle pust donner a veoir quelques contradictions dans la cronologie, ainsy que dans les vs & dans les doctrines du grand-homme, eû esgard principallement a la morale ».
De fait, si j'étais moi-même résolu d'emblée à suivre les opinions les plus modérées et les plus éloignées de l'excès qui fussent communément reçues en pratique par les mieux sensés de ceux avec lesquels j'aurais à vivre, et à ne suivre pas moins les opinions les plus douteuses, lorsque je m'y serais une fois déterminé, que si elles eussent été très assurées, bref, pour le dire d'un mot, à ne pas chercher midi à quatorze heures, et donc à interpréter les textes à la lettre, je craignis qu'effectivement Descartes se révélât, lui, pour le moins infidèle à la première des règles de sa morale, qui lui prescrivait avant tout d'« obeir aux lois & aux coutumes de [son] païs » : en ce cas il avait bien fallu en effet attendre trois siècles et demi pour que la contradiction fût levée.
En tout état de cause, le dossier comportait nombre d'incongruités, de nature à rendre le lecteur perplexe.
La première pièce en était une Lettre à Regius pour Chanut, non datée, mais que le contexte imposait de situer vers la fin des années 1640.
La lettre à Regius elle-même disait en effet ceci :
Vir Clarissime,
Quicquid est de nostro dissensu super cogitatione, quam tu corporis modum quemdam esse posse arbitraris, ego verò attributum principale seu essentiam substantiæ cogitantis censeo, non possum certè quin tibi gratias agam maximas quòd tam benignè Chanuto meo hospitium cibúmque Vltraiecti præbere annuisti dùm in Galliâ mihi peregrinandum est.
Quâre non profectò rursùs te rogandum est vt cures ne careat in patellâ suâ pulmonis aut piscis nec lactis in scutellâ, operamque des ne quicquam intermisceatur vacui capsæ eius inter arenulas vel ramenta pro materiâ quâ excrementorum eius colligendorum causâ vti constitueris. Abs te autem peto vt si quem in morbum cadat, caueas ne nimiùm sæpe eum purges neue eius festines sanguinem mittere : Ars enim, vt aiunt, longa, breuis autem vita.
Denique inuenies infrà, vt inter nos conuenit, primam earum epistularum quas te gallicè ei lecturum esse confido.
Vale & me ama.
Suivait donc la première lettre à Chanut :
« Mon bien-aymé,
Ie pense sans cesse a toy dans les prouinces que ie dois trauerser pour mes affaires, sans y iamais rencontrer parmy tes semblables qui que ce soit qui te pust égaler, ny mesme se mesurer a toy.
Demeure bien au chauld dans ton poësle 2, & ne te va point aduenturer dans les ruës, de peur de t'y heurter à des carrosses roulant à vne allure superieure aux vitesses authorizées.
Mange sans hesiter le mou ou la pastée que te fournit ton hoste. N'hesite pas à luy demander aussi des crocquettes si l'enuie t'en prend, puis que ie n'ay sceu treuuer moy mesme le mot pour les luy designer dans la langue de Schekspirius 3, a condition de songer a boire autant de laict ou d'eaue qu'il faut pour en compenser la secheresse.
Porte-toy bien, mon doux Chanut : ie te fourre la langue dans les oreilles. »
La lettre à Regius pouvait jeter quelque lumière sur les motifs personnels du rapprochement entre les deux hommes après l'âpre querelle évoquée dans la première phrase.
Je commençai toutefois par éclairer mon ami sur la querelle en question, en le renvoyant aux Notæ in Programma quoddam publiées par Descartes à la fin de décembre 1647, reproduites au tome VIII (p.335-370) de l'édition Adam et Tannery de ses Œuvres, qui se trouvait parmi les usuels de son bureau directorial, mais dont il n'avait jamais eu le désir ni l'occasion d'ouvrir les volumes. J'en profitai pour attirer son attention sur quelques autres citations et références de nature à l'intéresser, et à répondre aux questions que la suite du texte l'amenait à se poser.
À propos de l'interdiction faite au vide de s'immiscer entre les grains de sable ou à l'intérieur de la sciure de la caisse de Chanut, je lui signalai l'horreur qu'inspirait au philosophe le spectacle, mieux, la pensée même du vide : elle impliquait que, en l'absence de toute matière entre les parois d'un bol, celles-ci en vinssent à se toucher purement et simplement, que, si petits qu'ils fussent, les copeaux se trouvassent contraints, à défaut de la matière subtile nécessaire pour les séparer, de former ou reformer instantanément la bûche dont ils étaient issus, et de même pour les grains de sable rassemblés d'un seul coup en un caillou ou un rocher, pour les membranes du poumon collées en une peau unique, la chair du poisson toute entière confondue avec son arête, etc.
En ce qui concerne les excréments, j'attirai, entre autres, son attention sur la Lettre CDLXI au marquis de Newcastle du 29 novembre 1646 (AT IV p.568-577) vers la fin de laquelle Descartes aborde la question.
Jointe à l'obsession de la matière dont je venais de lui parler, au jeu de la réplétion et de l'évacuation qu'elle évoquait en son esprit, et à quelques autres associations, cette confirmation de l'intérêt que portait notre auteur à la collecte, la collection ou le recueil des excréments, l'amena à évoquer les séjours que certains des auteurs des Recueils qui l'occupaient quant à lui s'en allaient faire en Provence dans les années 80 du siècle suivant pour y ressourcer leur belle langue auprès d'un autre marquis de leurs amis, qui mettait à leur disposition des chambres d'hôtes pour les loger dans son château, de préférence avec leurs épouses, leurs maîtresses, et leurs enfants.
La dernière des précautions demandées par Descartes en latin à son ami le médecin Le Roy (épargner à Chanut l'excès des traitements couramment pratiqués par ses confrères) témoignait clairement de sa part d'une méfiance expliquant, comme je le dis à Simon, le retard qu'il mit à consentir à Stockholm qu'on lui appliquât la saignée lors de la maladie qui devait l'emporter, retard auquel ces Messieurs de la Faculté n'hésitèrent pas à imputer l'issue fatale de celle-ci.
Pour en finir avec la lettre à Regius, tout en assurant Simon de l'intérêt extrême que je portais à ses précieuses remarques, je lui suggérai aussi discrètement que possible de garder une certaine mesure dans ses extrapolations herméneutiques et analitiques, et d'accorder un tant soit peu plus d'attention à la lettre des propos du philosophe et à leur syntaxe.
Le lettre française, et celles qui les suivaient, ne posaient pas autant de problèmes de ce genre, mais en soulevaient d'autres.
On a vu dès la première, dont au reste le contenu recoupe largement celui de la lettre au médecin, l'extrême familiarité qu'elle manifeste avec le correspondant.
Les suivantes étaient du même ton, avec des formules tout aussi bizarres, comme (dans la troisième) « ie te remuë le nez dans les poils du ventre, en te caressant le dessoulz du col », ou (dans la septième) « ie te fay de gros bisouz sur le museau & sur les flans ». Dans la onzième lettre, il lui recommandait (je cite) de « lire mes ouurages quand tu auras appris a lire & a escrire, sans toutesfois, en vn premier tems au moins, aller audela de la Troisieme partie de mon Discours de la Methode, tant les meditations que i'ay rapportees ensuyte sont metaphisiques & peu communes, ny lire la quatrieme partie de mes Principes de la philosophie, de peur que les explications que i'ay voulu y donner des principaux phenomenes de la Nature te retienent de follastrer. » Dans la douzième, il lui recommandait de ne pas se laisser prendre le bout de la queue dans le montant de la porte comme cela avait failli lui arriver peu auparavant. Dans la quatorzième, qui est la dernière du recueil, il ne craint pas d'écrire : « Ie te grate le hault de la teste & ie frotte mon nés contre le bout du tien en attendant de te reuoir, puisque mon voïage s'achesue enfin. Ie te rapporteray des ioüets et des frïandises. A bientost mon gros bebe. »
Certes les lettres à Chanut publiées jusqu'ici témoignent d'une « tres-particuliere inclination » de Descartes envers lui. Dans celle par exemple du 6 mars 1646 (AT IV 376-379), il manifestait autant d'intérêt pour sa santé 4 que d'estime pour sa manière de philosopher et ses opinions (« ie voy que la pluspart des hommes iugent si mal, que ie ne me dois point arrester à leurs opinions ; mais ie tiendray les vostres pour des oracles »), et marquait fortement le souhait qu'il formait de le voir lors d'un passage à Paris, où sa présence serait même « l'vn des principaux suiets qui [le] pourroient obliger d'y aller. » Dans celle du 1er novembre de la même année, il limitait son espoir à le voir dans un avenir indéterminé faire une étape chez lui à Egmond : « tout ce que ie puis esperer, est que peut-estre, apres quelques années, en repassant vers la France, vous me ferez la faueur de vous arrester quelques iours en mon hermitage, & que i'auray alors le moyen de vous entretenir à cœur ouuert », déclarait que « Dés la premiere heure que i'ay eu l'honneur de vous voir, i'ai esté entierement à vous, & comme i'ay osé deslors m'assurer de votre bien-veillance, aussi ie vous supplie de croire que ie ne vous pourrois estre plus acquis que ie suis, si i'auois passé auec vous toute ma vie », puis, après avoir déclaré qu'en philosophe il trouvait les passions « presque toutes bonnes », concluait sur celles qu'il avait pour lui. Mais, précisait-il aussitôt, « à vostre égard les passions que i'ay, sont de l'admiration pour votre vertu, & vn zele tres-particulier » etc., de même qu'il avait précisé dans le passage précédent que « la longue frequentation n'est pas necessaire pour lier d'étroites amitiez, lors qu'elles sont fondées sur la vertu. »
Tout cela n'avait évidemment rien à voir avec le ton de nos lettres, et l'on regrettait d'autant plus qu'il ne s'en trouvât aucune de Chanut lui-même dans notre dossier.
Le détail qu'on a lu plus haut : « quand tu auras appris à lire et à écrire », pouvait rendre compte de ce dernier point, expliquer que le philosophe ait dû demander au médecin de donner à son correspondant lecture de ses missives, et suggérer une autre interprétation de la tendresse qu'il y exprimait : s'agissait-il d'un jeune frère de Francine, dont Pierre Chanut aurait bien voulu assumer la paternité nominale pour en décharger son ami, lequel n'en aurait pas moins reporté sur ce fils caché la tendresse qu'il portait à sa fille morte prématurément, au point de se laisser aller à de tels débordements ? Mais je ne trouvai rien qui fût de nature à corroborer cette hypothèse.
La datation des lettres de Descartes (et c'est bien ce que laissait entendre Clerselier dans l'avertissement que nous avons vu) n'était pas moins problématique.
De quel voyage parle-t-il dans la première ?
Celui qu'il effectue en France en 1647 se situe de juin à novembre : il faudrait donc situer la lettre à la fin du séjour pour expliquer l'invitation faite à Chanut de rester dans son poêle. Mais dès le mois de septembre de l'année au moins, Chanut est à Stockholm 5, et c'est à l'extrême fin de la même année que la querelle entre Descartes et Regius est à son comble. L'année suivante ne s'accorde pas non plus avec ce détail, puisque le voyage qu'accomplit Descartes en France cette année-là se situe entre mai et août, et que rien n'indique que cet été-là ait été exceptionnellement froid. De façon générale, on a du mal à dater toutes les pièces du dossier : dans le cas de nombre d'entre elles Chanut est bien à Stockholm et non à Utrecht, on ne peut être à la fois au four et au moulin, et la fonction d'ambassadeur, pour prestigieuse qu'elle soit, ne confère pas à ses titulaires le don d'ubiquité.
Le dossier comportait encore quelques pièces annexes, retranchées d'autres Lettres que Clerselier avait publiées par ailleurs.
Parmi ces retranchements, une remarque que Descartes avait ajoutée après coup sur la copie qu'il avait conservée d'une autre lettre à Regius, remontant au mois de janvier 1642 6 : en marge de la phrase sur laquelle s'y conclut son refus de voir dans l'homme un « être par accident », et sa réaffirmation de la réalité selon lui véritablement substantielle qu'est en l'homme l'union de l'âme et du corps : si enim Angelus corpori humano inesset, non sentiret vt nos, sed tantum perciperet motus qui causarentur ab obiectis externis, & per hoc à vero homine distingueretur, figuraient ces deux lignes autographes : Eodem modo cùm Angelus corpori felino insit, non sentit vt feles solent, sed tantum percipit motus qui causantur ab obiectis externis, & per hoc à verâ feli distinguitur.
D'autres phrases présentes originellement dans la correspondance avec la reine Christine au cours de l'année 1649 avaient été également supprimées : Descartes y faisait part à son auguste correspondante de ses doutes, hésitations et scrupules à accepter l'honneur qu'Elle lui faisait de l'inviter à sa Cour, dans la crainte où il se trouvait aussi bien de laisser derrière lui Chanut en Hollande, que de l'emmener avec lui à Stockholm.
En dépit de nos efforts pour associer nos savoirs et nos compétences, nous n'avions, Simon et moi, pas trouvé de solutions satisfaisantes ouvrant la voie à une édition acceptable des textes rassemblés par Clerselier.
Ceux-ci suggéraient bien, il est vrai, une autre piste à explorer pour tenter de rendre compte de toutes ces étrangetés. Mais elle était apparemment si contraire, comme le laissait aussi entendre Clerselier, à la doctrine du philosophe, qu'on hésitait à s'y engager.
Je me résolus néanmoins à tenter l'épreuve.
Je ne trouvai rien de précis dans le Fonds Baillet aux Archives du Val d'Oise, sinon une allusion à des Mémoires inédits d'un valet du grand homme dont le biographe avait tiré nombre de ses informations. Adrien Baillet mentionnait tout de même fugitivement le nom du valet : Daniel Boullieau, et la bourgade dont il était originaire, une localité proche de Dangé-Saint-Romain.
Après avoir vainement essayé d'exploiter ces indications aux Archives ou en bibliothèque pour enrichir ma documentation, je me décidai à mener une enquête sur place, en cherchant au village s'il existait des traces du personnage, voire, ce que je n'osais espérer, du recueil même de ses souvenirs.
Je recherchai sur le web toutes les familles portant le nom indiqué par Baillet qui pouvaient subsister à Dangé-Saint-Romain ou dans les environs, et après avoir pris sans succès contact avec trois d'entre elles, je finis par trouver celle où l'on conservait la trace, et mieux que cela, de ce lointain ancêtre. Je pris à la gare Montparnasse le TGV pour Châtellerault, puis un taxi pour le hameau, où je fus accueilli à bras ouverts dans la famille.
On m'emmena bientôt voir derrière l'Église ce que l'on nomme là-bas les pierres datantes, parmi lesquelles celle de Daniel Boulliau (1621-1679), et, à côté d'elle, celle de Chanut (1641-1660), une dalle étrangement petite pour ce grand jeune homme trop tôt disparu.
On me régala le soir d'un savoureux repas d'huîtres, arrosé (hélas !) d'un vin blanc produit sur leur domaine.
Et l'on m'y fit voir le trésor, conservé dans un petit coffre-fort dissimulé derrière une armoire : un épais in-quarto relié en parchemin, consolidé par des ferrures inaltérables, fermées grâce à un solide verrou dont les Boulliaud gardaient la clé dans un autre lieu secret, en attendant le jour où, immanquablement pensaient-ils, des chercheurs autorisés et de toute confiance viendraient y exploiter une mine de renseignements inouïs.
Je m'installai le temps qu'il fallut à Châtellerault, où je pris la demi-pension à l'Auberge des Trois Cerfs pour passer la journée chez les Boulliaud à consulter l'ouvrage, dont la page de titre portait en gros caractères : Mémoires d'un valet, par Daniel Bouilliau.
Sans les négliger entièrement, car on risque ce faisant de manquer l'occasion de recueillir des indications intéressantes, je passai rapidement sur les premiers feuillets où le valet rapportait ses souvenirs d'enfance et de jeunesse, ses premières amours et ses premiers emplois, pour en venir dès que possible à ce qui m'avait amené ici.
Daniel Boulliaud avait servi sous divers maîtres en France, aux Pays-Bas, en Suède, puis en Espagne et en Italie, avant de retourner en Poitou quelque temps après le Traité d'Aix la Chapelle vivre entre ses parents le reste de son âge.
Il avait, après Hélène et quelques autres servantes, été engagé comme valet par le philosophe – lequel escomptait par là, entre autres, s'éviter désormais la multiplication d'une descendance autre que spirituelle –, à la suite d'une annonce parue dans la Feuille du Bureau d'Adresse datée du 1er mai 1642 : « Philosophe Poicteuin de renom demeurant en Holande cherche seruiteur, de preference François, sçachant lire, escrire, & conter, nourri, logé & habillé, pour tenir son mesnage & pourueoir à sa table, veiller a sa tranquilité & escarter les importuns. Gages de trois guldens par mois, a debatre. Escrire au iournal, qui transmettra. »
(Lorsqu'à mon retour je fis part à Simon de mes découvertes, il me fit remarquer en passant qu'on tenait là un précieux témoignage, apparemment unique, de ce numéro du périodique, dont aucun exemplaire n'a été jusqu'ici recensé.)
Daniel Boulliaud rapportait ensuite ses démarches pour obtenir la place, dont le succès fut facilité par le voisinage de son lieu de naissance avec celui du philosophe, puis en venait à son arrivée en Hollande et à sa prise de contact avec son futur maître.
« I'obtins », écrivait-il, « que le montant de mes gages fust porté a trois guldens & demy, a quoy vint s'adiouster vn autre suplement : si Monsieur Decarte auoit soüaité que ie sûsse lire & escrire, c'est qu'il comptoit aussy sur moy pour repondre en sa place aux plus fascheux de ses correspondans, tels que partisans entousiasthes, amateurs ignorans, teologiens obtuz, astrologues, chymistes, & autres illuminez, pedans de college &c, se bornant a relire & corriger mes broüillons, ce que i'acceptay moyennant vn complement de gages de ½ gulden par mois. C'est toutes-fois a vn pedant du voisinage qu'il eut recours pour me faire donner (a mes frais) les lessons d'ortografe qui m'estoient encore necessaires pour m'acquitter conuenablement de ces tasches-la. Arguant que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, le principal estant de l'apliquer bien, Monsieur des Quartes crust aussy, pour m'ayder dans l'acomplissement de ce trauail, debuoir m'apprendre luy-mesme beneuolement a raisonner quelque peu, ce dont, deguisé en medecin, ie sus faire bon vsage vne quinzène d'années apres sa mort pour deffendre les interests du Ciel, lorsque, sous vn nom d'emprunt, i'auois a seruir vn autre maistre moins respectueux que luy de la religion de ses peres, ce qui luy valut d'auoir a succumber a la fin sous la Puissance d'vn Esprit plus fort encore & plus Malin que luy, au detriment de mes gages, lesquels me resterent ceste fois tout-a-fait impaïez. »
Daniel (appelons le désormais simplement ainsi pour faire bref) s'attachait ensuite à la description du logis, des places et rues environnantes, des commodités qu'on y trouvait, des habitudes du maître et de ses diverses relations.
Venaient ensuite des considérations offrant davantage d'intérêt pour ma recherche.
« Lors des leçons qu'il vouloit bien m'acorder », écrivait-il, « Monsieur d'Escartes m'auoit parlé plus d'vne fois du seul moïen dont nous disposions, selon luy, pour acceder a quelque verité, assçauoir ce regard de l'esprit qui nous la fait saysir instantanement.
Ces propos m'ayderent plus tard a comprendre pourquoy, auec la meilleure volonté du monde, ie ne pouuois m'empescher de treuuer terne le regard qu'auoit donné à Monsieur Des Carthes le peintre fameux quy s'en estoit venu le pourtraire en son logis. La raison en estoit, comme me le confirma bien-tost Maistre François lors qu'il y vint aporter quelques retouches, que l'obligation ou il mettoit son modelle de prendre longuement la pause ne lui permetoit pas de representer en ses yeux ces esclairs par lesquels, selon mon maistre, le philosophe receoit les especes porteuses de veritez & les exprime : aussy dut-il se resigner à laisser ces coups d'œil en puissance, ou dans le flou, en attente seulement de telles fulgurations, ou dans leurs interualles. »
Après d'autres récits et d'autres remarques, au reste du plus haut intérêt, Daniel en venait enfin à ce qui avait motivé ma venue en Poitou :
« Des mon arriuee a Endegeest, i'auois representé à Monsieur Des Quartes qu'il ne pouuoit continuër de viure sans vn chat, surtout en vn païs tel que celuy-la, ou ne cessent d'aborder des vaisseaux aportant abondamment tout ce que produisent les Indes & tout ce qu'il y a de rare en Europe, & auec cela aussy les rats qui s'en repaissent en leurs cales, & s'en vienent rejoindre ceulx d'icy, qui s'en repaissent à leur tour. De fait, m'aduoüa-t-il, ceux qui infestoient son logis luy auaient desia deuoré une bonne partie de ses escrits, & il debuoit a ce que, pour faire contre mauuaise fortune bon cœur, il appella plaisamment “leur critique rongeuse”, la perte des dernieres pages de son Monde. Il se resolut doncques a se ranger a mon aduis, & ie n'eus pas de peine a luy procurer vn ieune chat tigré, de bonne taille & bon chasseur, qu'il designa d'abord simplement comme “le chat”, puis, pour obeir aux loys & coustumes de son païs, denomma bientost “Minou” ou “le Minou”. Mais il n'y auoit de sa part dans cette appelation & cette coutume nulle trace d'affection : Monsieur Decarthes estoit au contraire prodigieusement agacé par l'habitude qu'ont les chats d'apporter leur proye à leurs maistres comme s'il s'agissoit d'un cadeau, sur-tout lors que cela se passoit dans son bureau, iusques sur sa table de trauail, ce qui ne contribuë pas peu à explicquer le nombre des erreurs qui se sont glissées dans ses Reponses aux Obiections du Pere Gassendus & les marques d'impatience & d'iritation qui s'y manifestent.
Tout cela ne cessoit de renforcer iusqu'à l'exasperation l'animosité qu'il ressentoit enuers ces animaulx comme enuers toutes les bestes, mesme lorsqu'il luy estoit donné d'obseruer dans leur conduite vn ordre manifestement deliberé, que, au risque de se contredire dans les termes mesmes, il s'obstinoit a persifler en s'en prenant par exemple au comportement “des chiens & des chats, qui grattent la terre pour [c'est moi qui souligne – D.B.] enseuelir leurs excremens, bien qu'ils ne les enseuelissent presque iamais : ce qui monstre qu'ils ne le font que par instinct, & sans y penser.”
Vn iour toutesfois, il dut s'aduoüer surpris de voir le minou, après avoir laissé en effect dans sa caisse vne grosse crote, se retourner vers luy pour lui lancer un vif coup d'oeüil avant de s'enfuir au grand galop iusqu'au fond du logis.
Mr Deccarte prétendit neanmoins douter encore, &, pour euiter de se laisser aller à l'illusion d'vne euidence, tenter de balancer a reconnoistre dans ce regard la marque d'vne veritable intention, dont il hesitoit aussy à reconnoistre l'obiet.
Mais, m'expliqua-t-il plus tard, l'eschange de regards qui auoit suiui la scene l'auoit, quoy qu'il en eust, conuaincu d'un coup que le Minou auoit bel & bien vne idee claire & distincte d'vn principe d'oëconomie d'ou s'ensuiuoit vne regle de repartition des tasches, commandant au chat de montrer sa bonne volonté en commençant d'enfoüir ses excremens, puis, vû l'impossibilité manifeste ou il se trouuoit d'y paruenir luy-mesme, d'en laisser le soin au maistre (c'est-a-dire, en l'occurrence, au valet de celuy-ci, bref, a moy-mesme).
Quant a l'aprehension qu'il auoit eüe d'y voir de la volonté, de l'intention, & donc de la pensée, de peur d'auoir à en attribüer aussy le meritte aux huistres & aux esponges, & de ne plus pouuoir deslors refuser aux molusques & aux ecchynodermes, avec l'esperance de l'immortalité de leur ame, la gloire de la resurrection de leurs corps, il s'en consola par la confiance qu'il conseruuoit de descouurir quelque jour par le raisonnement aydé des experiences vn autre lieu pour y establir vne barriere infranchissable entre ce qui doit estre separé.
S'estant ainsy rendu a l'euidence que luy auoit offerte le chat, il decida en-fin de luy donner le nom d'vn de ses plus chers amis : Chanut, d'autant, adiouta-t-il en plaisantant toûsiours, que cela faisoit ce qu'il appella “vne belle hentyfraze”, l'animal estant doté d'une fourrure abondante.
C'est du reste a cette ocasion que, voïant la difficulté que i'auois euë a escrire le terme de rethorique qu'il venoit d'emploïer, Monsieur des Carthes me proposa de mettre fin aux leceons d'ortografe qu'il m'auoit faict prendre iusques-la, ce à quoi je consentis d'autant plus volontiers que, comme je l'ai dit, il en retenait le montant sur mes gages.
Au reste, le retournement du jugement qu'il avait ainsi porté sur son chat l'amena rapidement à se prendre pour lui d'une véritable passion, avec toute la force qu'entraîne le déchaînement de tendances si longtemps refoulées.
Il tenait à le nourrir lui-même, le prenait avec lui dans son bureau, le couvrait de toute sorte de caresses, et l'invitait à partager son lit.
Me laissant le soin de rouler pour lui des boulettes de drap ou de papier, il se plaisait à lui fabriquer lui-même de petites pelotes de laine bien serrées et allongées, non sans les accompagner d'un fil dépassant d'un ou deux pouces, que Chanut consentait à faire mine de prendre pour des souris lorsque notre maître commun les lui jetait pour qu'il les lui rapportât en mains propres.
Cette expérience toute nouvelle pour lui l'incita également à aborder une question qu'il n'avait jamais traitée jusqu'alors, ce qu'il fit dans quelques feuilles dont il me dicta le titre : Quô sensu homines nec non bestiæ ludere per actionem inter se corporismentisque soleant, Angeli & Deus solô spiritu, afin de les joindre à sa lettre au R.P. Mersenne du 16 novembre 1646 7.
Toutes ces nouveautés n'allaient pas sans quelques inconvénients : accrocs et déchirures, jusqu'à la hauteur de quatre pieds, dans les tentures, griffures sur les meubles et les fauteuils, courtepointes en lambeaux, etc.
Monsieur Descartes me chargea de faire appel à un tapissier pour réparer ou remplacer les pièces abîmées, à un chimiste ou un apothicaire pour fournir un produit susceptible d'en détourner Chanut, et à un menuisier pour fabriquer à son intention le griffoir le plus attrayant et le plus performant possible.
Lorsque le premier des marchands sollicités s'en vint chez nous, je ne pus qu'observer son coup d'œil désapprobateur devant tous ces dégâts, et, plus encore peut-être, devant le spectacle du chat moelleusement couché sur le lit du philosophe.
Aussi résolûmes-nous tous les trois de ne plus rien divulguer de cette situation : ainsi, lorsque Monsieur Clerselier venait chez nous commencer à classer les papiers du maître, dont certains étaient, de son propre aveu, « si broüillés que i'aurois moy mesme beaucoup de peine a les lire », j'enfermais Chanut, avec son accord, dans un placard, non sans y avoir mis à sa disposition toutes les commodités nécessaires. »
La suite du récit de Daniel apportait d'autres détails qu'il n'est pas nécessaire de rapporter ici : ce que nous venons de voir suffit largement à rendre compte des énigmes apparentes de la correspondance qui m'avait amené en Poitou.
L'épisode rapporté dans les Mémoires se terminait sur l'évocation des quelques mois passés encore en Suède au service d'un autre maître afin de permettre à Chanut de profiter des longues journées et des claires nuits de l'été boréal pour vagabonder, chasser, pêcher et batifoler à son aise au bord des lacs et dans les forêts, puis sur le retour de Daniel en automne à Dangé-Saint-Romain pour l'y laisser avec toutes les recommandations utiles, avant de repartir servir sous d'autres cieux.
Je compris pourquoi Clerselier, ou un de ses comparses, avait préféré mettre sous le boisseau l'opuscule de 1646 sur le jeu, et pourquoi Descartes n'avait cessé de différer la publication de son traité De l'Homme, dans la crainte où il se trouvait que ses « neveux croient jamais que les choses qu'on leur dira viennent de moi lorsque je ne les aurai point moi-même divulguées. »
Je compris mieux aussi ce qu'il voulait dire lorsqu'il écrivait que pour savoir quelles étaient véritablement les opinions des gens, on devait « plutôt prendre garde à ce qu'ils pratiquaient qu'à ce qu'ils disaient ; non seulement à cause qu'en la corruption de nos mœurs il y a peu de gens qui veuillent dire tout ce qu'ils croient, mais aussi à cause que plusieurs l'ignorent eux-mêmes, car l'action de la pensée par laquelle on croit une chose, étant différente de celle par laquelle on connaît qu'on la croit, elles sont souvent l'une sans l'autre. »
La recherche a encore de beaux jours devant elle.
1
Olivier Bloch s'est largement inspiré de ce récit pour la rédaction de son article « Sur une correspondance inédite de Descartes » paru dans la revue Dix-septième siècle, numéro 240, 60e année, n° 3, juillet 2008, p. 549-558. Mis en ligne sur Cairn.info le 11/09/2008 : cf. https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle.
2 Sur ce point, voir Mariafranca Spallanzani, « “Le poësle” de Descartes – La “vie retirée” et la “recherche de la vérité” du philosophe », dans Bernard Bourgeois et Jacques Havet éd. L'esprit cartésien, 2 vol., Paris, Vrin, 2000, p.1252-1263.
3 Sic. Descartes doit songer à l'oratorio profane des frères Lawes, Leharius Rex, sur un livret du chancelier Francis Bacon, célèbre pour son grand Air du Doute : « Suis ie, ne suis ie pas ? cruële question » chanté par Cordélia en butte aux pièges que lui tendent les Mauvais Génies de la Forêt d'Ardenne, dont, à en croire Adrien Baillet s'appuyant sur une lettre d'octobre 1637 à Constantin Huygens, il avait entendu une exécution à Amsterdam lors d'une nuit d'été de l'année précédente.
4 « La rigueur extraordinaire de cet hyuer m'a obligé à faire souuent des souhaits pour vostre santé & pour celle de tous les vostres ; car on remarque en ce païs qu'il n'y en a point eu de plus rude depuis l'année 1608. Si c'est le mesme en Suede, vous y aurez veu toutes les glaces que le Septentrion peut produire. Ce qui me console, c'est que ie sçay qu'on a plus de preseruatifs [j'engageai Simon à ne pas s'attarder à ce terme, d'autant que les lignes suivantes indiquent que le meilleur d'entre eux est de passer « la pluspart du temps dans un poesle », dont rien ne dit qu'il puisse s'agir d'un sauna] contre le froid en ces quartiers-là, qu'on n'en a pas en France, & ie m'assure que vous ne les aurez pas negligez. »
5 Voir les lettres CDXCIII, CDXCIV, CDXCV et CDXCVI (AT V, p.79-88).
6 Voir AT III, p.491-520 ; la phrase citée figure p.493.
7 La lettre figure effectivement, avec cet Appendice, dans le dossier Chanut.
|